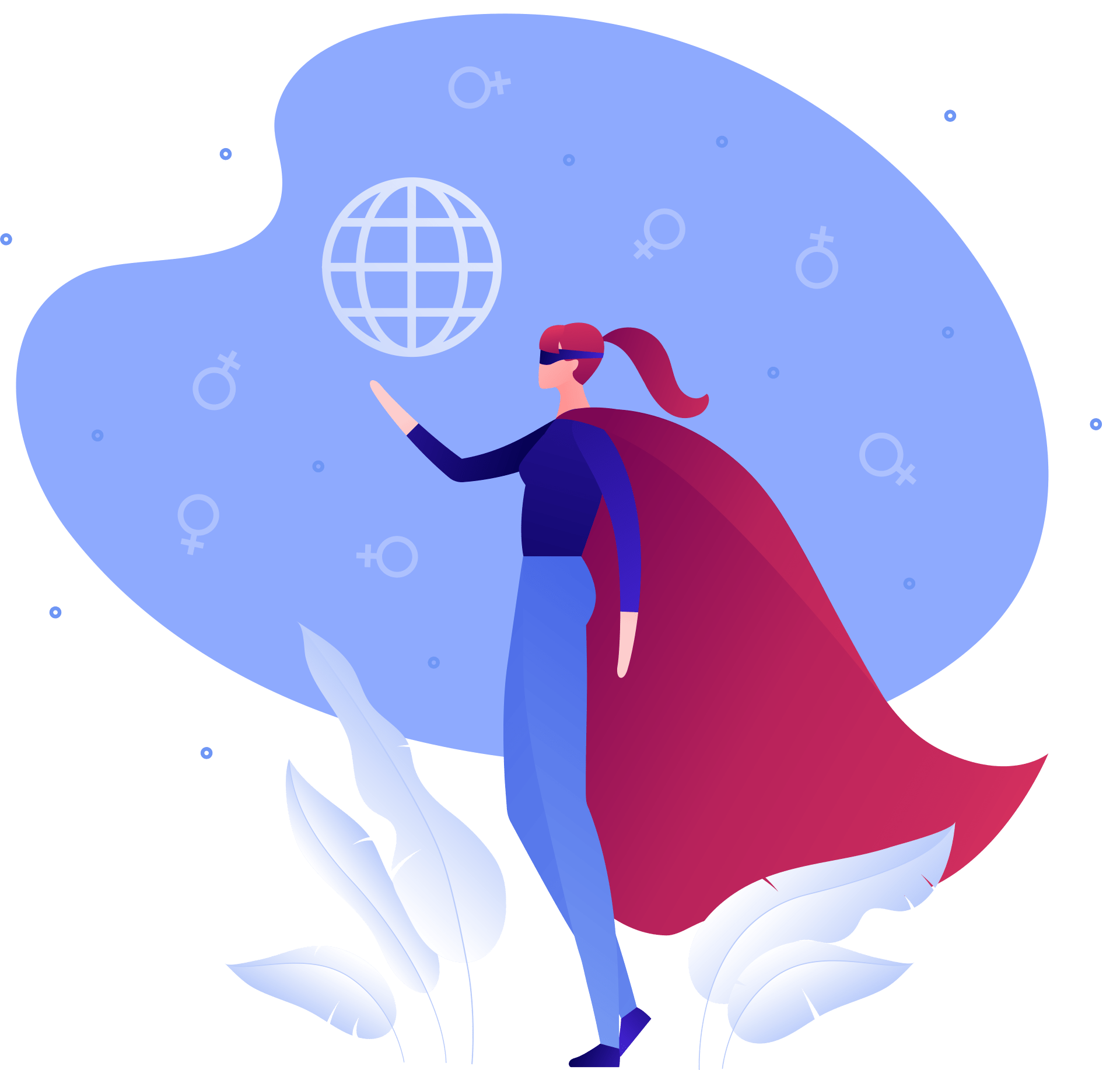Personne dans la rue lors du 50e anniversaire de la loi Veil. Qu’est-il advenu du féminisme ? Depuis le boom des années 2000, on s’aperçoit que ces combats physiques se sont associés à des combats numériques. Émergent alors depuis une dizaine d’années, des figures hybrides qui mêlent à la fois les figures d’activistes et d’influenceurs. Dans la rue, il y a des codes à respecter tandis que sur le web, il est plus facile de passer outre les lois. Les féministes qui investissent la toile le font pour s’émanciper de ces codes législatifs et diffuser leurs idées, libérées de ces carcans. Le web permet aussi une libération plus rapide des différents types de féminisme, appelés “sous-culture du féminisme” : le pop-féminisme et la girlhood culture. Ces deux mouvements pensent que malgré les progrès déjà obtenus par les féministes des premiers temps, il reste des inégalités de genre. Le shitposting apparaît alors. Il représente une forme d’interaction en ligne visant à perturber les normes déjà établies pour mettre en avant des contenus volontairement désorganisés et de faible qualité. Beaucoup de filles entre 15 et 20 ans s’emparent de ce phénomène pour prendre part aux combats féministes. Mais de manière générale c’est davantage les jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans qui sont les plus concernées par le féminisme digital qui regroupe ces courants. Ils sont tous basés sur le témoignage personnel et non plus sur l’identité collective comme c’était le cas durant les deux premières vagues du féminisme (fin XIXe-1985). La philosophe Sarah Ahmed a définit cela par le concept “d’économie affective”. Quand les émotions circulent, elles renforcent le militantisme ou les réactions hostiles auxquelles est confronté le “féminisme de hashtag” (autre nom du féminisme digital). C’est ce qu’on a nommé le backlash, un contrecoup qui voit émerger des discours antiféministes voire masculinistes de la part de femmes et d’hommes. Les principaux sont les mouvements des tradwives et des mascus. Le premier regroupe des influenceuses “patriotes” qui prônent un retour aux valeurs traditionnelles tandis que le second estime que le féminisme nuit à l’image de l’homme en le rendant moins virile.
Ce concept venu des Etats-Unis se retrouve en France depuis quelques années. Jules Spector expliquera dans un article comment la fondation américaine Atlas exporte des idéaux masculinistes d’extrême-droite en France. Trois autres mouvements détournent également le concept premier du féminisme. L’article de Rachele Luisari sur la monétisation de l’activité des tradwives et celui de Laura Thommerel sur le “féminisme washing”, un concept qui montre que les entreprises récupèrent la cause des femmes pour en tirer des bénéfices reviendront sur ce phénomène. Celui de Chloé Kalusevi parlera des coachs en séduction qui donnent des conseils sexistes. Ces sortes d’anti-féminisme diffusées exclusivement en ligne amènent souvent à des campagnes de cyberharcèlement. L’article de Jessy Lemesle & Hilan Hill nous raconte l’histoire des streameuses sur Twitch. Deux articles d’Amélie Schaeffer et Luca Viero de Castro montreront que les femmes s’y trouvent stigmatisées et sous-représentées.
Cependant les réseaux sociaux ne sont pas qu’une avalanche de critiques antiféministes, on trouve aussi des figures qui retournent les stéréotypes misogynes à leur faveur. C’est ce que démontreront les articles de Lila Martin sur “Tanaland”, un concept purement numérique qui désigne un pays imaginaire réservé aux femmes. Et le podcast de Richard Casazza-François & Raphaël Persyn à propos de Taylor Swift qui remet le mythe de la femme à chats au goût du jour. Pour finir sur une note positive, on verra que les réseaux sociaux peuvent libérer la parole en matière de santé avec un article de Margaux Fresnais et Charlotte Le Balch sur l’endométriose. Les femmes prennent également toujours leurs combats à bras le corps c’est ce que démontrera Emma Ropers avec une enquête sur les femmes qui font de leur corps un business.