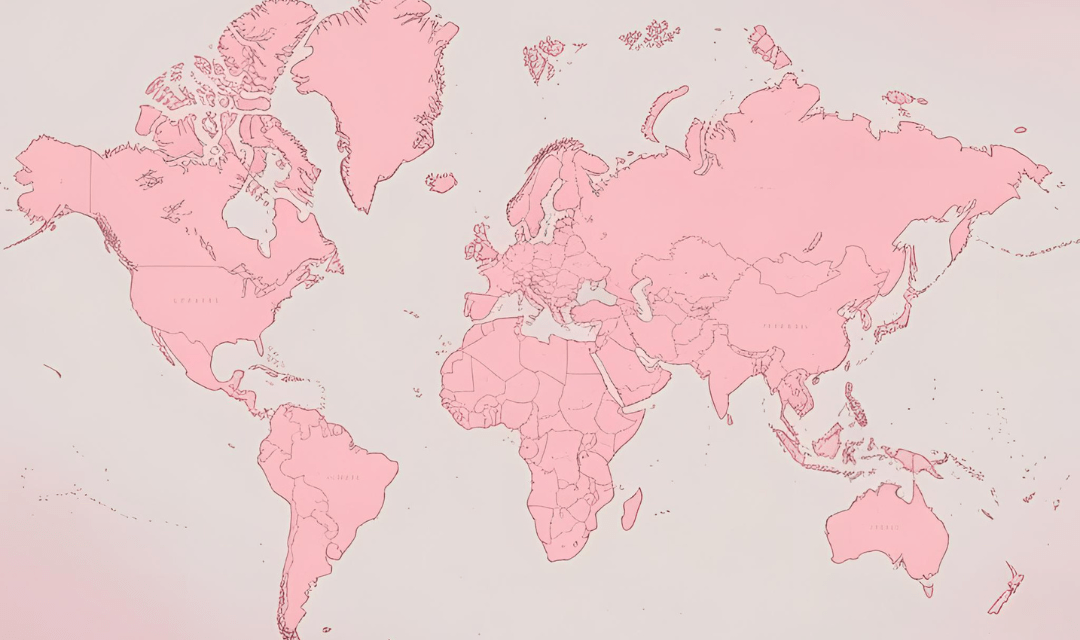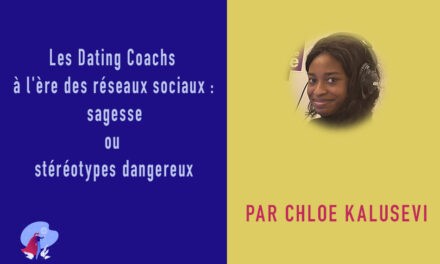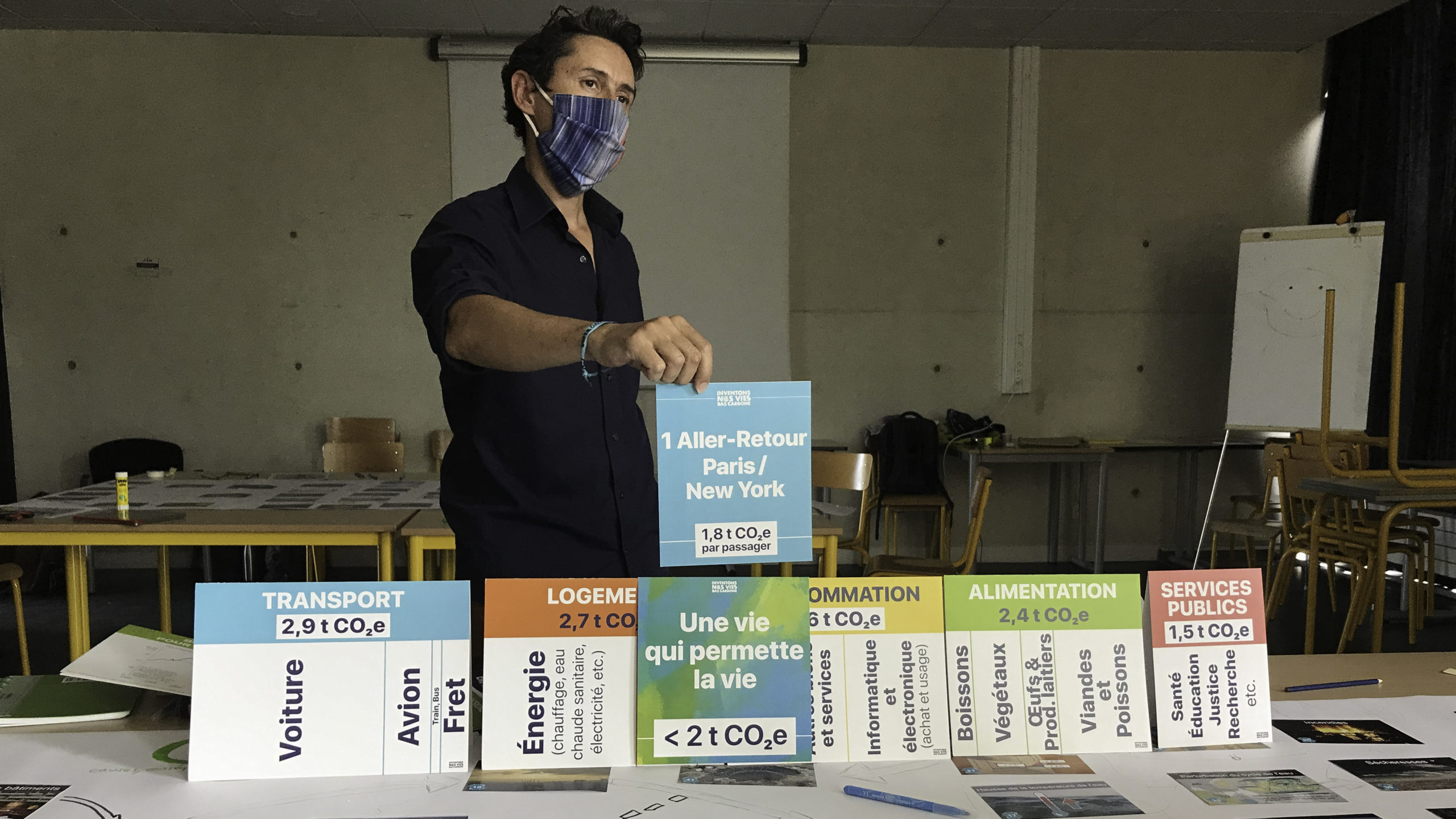En octobre 2024, l’insulte sexiste “tana” a fait son apparition sur Tiktok. Les jeunes femmes visées par cette injure l’ont récupérée pour créer Tanaland, un pays fictif 100% féminin. Ce phénomène viral illustre un concept sociologique courant dans le militantisme : le retournement du stigmate.
Une nouvelle injure misogyne a fait son apparition sur Tiktok en octobre 2024 : “tana”. Ce terme, tiré d’une chanson du rappeur Niska, est un équivalent des mots pute ou salope, bannis des commentaires du réseau social. En réaction à cette (énième) attaque sexiste, les Tiktokeuses ont décidé de se la réapproprier pour créer le pays fictif de “Tanaland”, un état réservé uniquement aux femmes.
“Le symbole derrière ce mouvement, c’est le ras-le-bol de recevoir des insultes misogynes à longueur de journée, explicite l’influenceuse @Toomuchlucile dans un Tiktok publié en septembre 2024. « On aimerait avoir un endroit où s’habiller comme on veut, dire ce qu’on veut, faire ce qu’on veut, sans être traitées de tous les noms.” Marie-Anne Paveau, professeure en sciences du langage à l’université Paris 13, s’intéresse à Tanaland au travers du concept de resignification. “C’est la réappropriation d’une insulte, qui devient une sorte d’étendard d’identité et de fierté”, raconte la théoricienne. D’autres chercheurs nomment ce processus la réappropriation ou encore le retournement du stigmate. Et pour que ce phénomène puisse avoir lieu, plusieurs conditions doivent être réunies.
Plusieurs critères pour qu’il y ait resignification
D’abord, il faut être concerné par l’injure. “Par exemple, moi, qui suis une femme de 59 ans, je ne peux pas resignifier tana, parce que je n’ai pas reçu cette attaque-là et que je ne suis pas dans la classe d’âge ni dans la catégorie visée,” explique Marie-Anne Paveau. La personne qui reçoit l’injure doit aussi être affectée : ”Judith Butler, philosophe américaine, présente cela sur le siège de la blessure”, ajoute la linguiste. Cette interaction doit ensuite être suivie d’un déplacement de contexte lors de sa réutilisation. Les tanas reprennent ce terme, péjoratif dans la bouche de ceux qui leur adressent, pour le retourner à leur avantage.
Mais ce processus n’est pas né avec Tanaland. En 2011 par exemple, les “Slutwalks” (Marches des salopes) réunissent des femmes à Toronto, puis partout dans le monde, qui protestent contre les violences sexuelles, la culture du viol et le slut-shaming (entre autres). “La resignification apparaît souvent, mais pas toujours dans un contexte féministe. Par contre, je pense qu’elle apparaît toujours dans un contexte militant”, avance Marie-Anne Paveau. Les lesbiennes, ont récupéré le mot gouine pour en faire un étendard d’identité. Comme pour Tanaland, l’idée d’un “Gouinistan” a aussi été évoquée, “mais c’est resté argumentatif” précise la professeure.
Tanaland : un cas de double retournement du stigmate
Au contraire, Tanaland est un concept très concret. Sur les réseaux-sociaux, les jeunes femmes se filment en train de fermer leurs valises pour s’envoler vers leur nouveau territoire. L’idée d’un gouvernement est également évoquée, avec, pour présidente pressentie, l’artiste Aya Nakamura. La chanteuse de pop urbaine est, elle aussi, régulièrement victime d’attaques sur les réseaux, en raison de son genre mais aussi de sa couleur de peau. Avec les réseaux-sociaux, le retournement du stigmate est plus rapide qu’avant et peut rapidement rendre un phénomène viral.
Dans le cas de Tanaland, Marie-Anne Paveau parle même d’une double resignification. Les jeunes femmes se réapproprient le mot, mais agrémentent aussi leurs Tiktoks d’une esthétique “girly” très marquée. Ces tiktokeuses se maquillent, portent des robes, des jupes, du rose, etc. “Elles revendiquent la culture Barbie, qui a été un petit peu restaurée grâce au film, mais reste une culture qui est très méprisée, jugée superficielle” analyse Marie-Anne Paveau.
“Cet univers fictif met en lumière un besoin pour les femmes de créer des lieux loin du harcèlement masculin”
Pour Marie Lafon-Bach, doctorante en sciences de l’information et de la communication, le succès de Tanaland sur Tiktok pose aussi la question de la non-mixité sur les espaces numériques : “Cet univers fictif met en lumière un besoin pour les femmes de créer des lieux loin du harcèlement masculin.” D’après la chargée de travaux dirigés à la Sorbonne Nouvelle, cela peut se rapprocher des initiatives de non-mixité qui existaient bien avant les réseaux numériques. “La non-mixité apparaît dès les années 1890 et les réunions entre femmes s’imposent durant la décennie 1970 comme un levier privilégié de partage d’expérience et de politisation du privé, ajoute Marie Lafon-Bach. La sociologue souligne “une grosse résonance” entre ces événements du 20ème siècle et ce qu’il se passe aujourd’hui en ligne, en pleine quatrième vague des mouvements féministes.